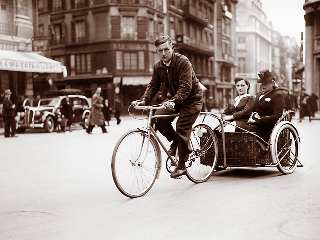|
Personne
n’a le droit de commander une voiture sans autorisation administrative
 |
En
1945 , la France vit une drôle de paix dans une économie de pénurie.
En 1948, personne n’a le droit de commander une voiture sans
autorisation administrative et les allocations d’essence sont
strictement mesurées. Un décret n’autorise les constructeurs
à vendre 1 auto en France que s'ils en exportent 3.
C’est
dans ce contexte qu’affluent les commandes vers la 2CV
tandis que faute de machines neuves et de matières premières
la production démarre au compte goutte.
(800 en 1949 – 6000 en 1950 )– Très vite les listes
d’inscriptions s’allongent au point que Citroën doit établir
des priorités |
|
Boulanger
n’a jamais oublié ce jour de 1935 où il avait remarqué les
nombreuses charrettes des paysans qui encombraient les routes
pour aller à la foire. Ces carrioles attelées d’un cheval ou
d’un âne lui semblaient l’image du retard d’équipements
des campagnes françaises .
Dans
le monde de l’entre deux guerres secoué par les progrès
techniques, 8.000.000
de paysans continuaient de cultiver leurs champs avec les outils
et les méthodes de leur grand père. |
 |
|
Boulanger
pensait à l’économie de temps et d’argent que leur
procurait une petite voiture sobre et pratique. Pour lui, la
cause était entendue.
C’était d’abord pour motoriser les
fermes isolées dans la France profonde qu’il valait faire la
TPV.
En
conséquence, les campagnards et leurs entourages tels
les médecins, curés, vétérinaires, artisans, représentants
figuraient en tête des listes d’attente. Mais on s’aperçut
rapidement que bien d’autres catégories réclamaient le 2CV
|
 |
 |
La
vie en France fut loin de redevenir normale dès la Libération.
Les restrictions du temps de l’Occupation continuèrent.
En
ce qui concerne la production automobile, l’État disposait de
nombreuses façons d’intervenir, en amont et en aval, et ne
s’en privait pas, ce qui faussait considérablement le marché.
En
amont, le gouvernement agissait par le contrôle des
approvisionnements avec tout un arsenal de moyens réglementaires
dans les attributions des crédits, des matières premières,
des machines et de l’énergie.
|
En
aval, il contrôlait le marché par des quotas obligatoires
d’exportation, l’obligation de servir ses prioritaires (armée,
administration), la taxation arbitraire des prix et le rationnement de
la distribution : chaque acquéreur potentiel devait préalablement
se procurer auprès des fonctionnaires idoines une licence d’achat
attribuée en nombre limité et selon des listes de catégories
professionnelles. À cela s’ajoutait le rationnement de l’essence,
en deux secteurs de prix définis eux aussi selon l’activité exercée.
 
Le
résultat n’était guère brillant. En 1948, le parc automobile français
ne représentait que 60 % de celui de 1938. Dans un article de
fond, Charles Faroux révélait en septembre 1948, qu’en un an, 40 000
voyageurs de commerce avaient pu acheter 24 voitures ! “Un
constructeur, écrivait-il, livre sur le marché intérieur 3 076 véhicules,
2 420 sont alloués aux ministères et aux administrations, 656 à
ceux qui travaillent.”
En
octobre 1948, on annonce l’instauration d’un régime de “liberté
proportionnelle”, terme ambigu qui signifie que 10 % de la
production d’un constructeur doivent aller aux prioritaires de l’État,
60 % à l’exportation, moyennant quoi 30 % pourront être
vendus “librement” (mais aux prix bloqués par l’administration)
sur le territoire français. Ce n’est que vers l’année 1949 que la
pression de l’État commencera à se relâcher – et que la ruée des
acheteurs provoquera, par leur nombre, de nouvelles attentes
obligatoires.

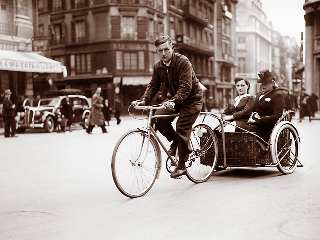
|